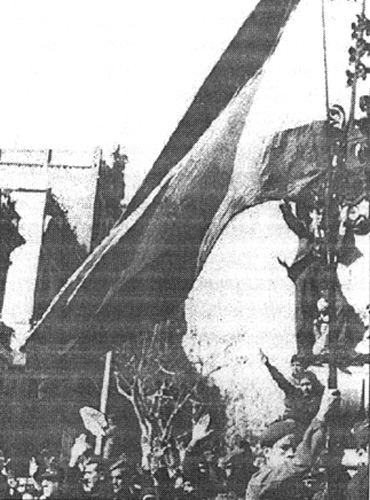—75→
Mon père fut interné à Argelès, tandis que ma mère, ma soeur Esperanza, âgée de 19 ans, et moi, de trois ans son aînée, nous continuions la route jusqu'à Cognac.
Esperanza dut être hospitalisée pour une appendicite suivie de complications. Les premières semaines, ma mère et moi obtenions deux fois par semaine, une autorisation de quitter le camp pour lui rendre visite. Mais je ne sais pas pourquoi, au bout de trois semaines, ces sorties furent interdites et nous n'avions plus qu'une autorisation une fois tous les quinze jours.
Une religieuse de l'hôpital nous disait: «Il n'y a que le soleil de l'Espagne qui réussirait à la guérir.» Elle nous avait presque convaincues, la bonne soeur. J'ai donc écrit à mon père. Heureusement, avec bon sens, il a répondu: «Si ma fille doit mourir, elle mourra en France.» Tous les jours, je faisais le mur pour lui rendre visite.
Vers midi, on nous distribuait nos rations de pain et de riz, avec, parfois, un morceau de fromage. Je faisais le pitre pour me faire remarquer du gardien, car il était important qu'il se souvienne de m'avoir vue au cas où on m'aurait cherchée l'après-midi. Puis, dès que j'avais reçu ma ration, je quittais ma mère et je me glissais, en rampant, sous la clôture électrifiée du camp. Le soir, la même prudence me permettait de regagner le camp. Pour me procurer un peu d'argent, le matin, au cours de la promenade, je ramassais des escargots et, lorsque j'en avais un cent, je les vendais à une fermière qui m'en donnait 5 francs. Avec cette somme, je pouvais, l'après-midi, passer à l'épicerie. Ainsi, je n'arrivais jamais à l'hôpital les mains vides.
Teresa SCHMIDT, à Lectoure.
Je me souviens des premiers trains de soldats républicains qui passaient à Grisolles où j'habitais. Je revois ces hommes avec leurs «calots à pompon» fatigués, meurtris certes, mais courageux, levant le poing.
Grisolles a hébergé une cinquantaine de réfugiés. M. Marcillac, maire à l'époque, avait mis à leur disposition deux fermes inoccupées, au lieu dit «Carrière», à la sortie du village, en bordure de la RN 113, en direction de Dieupentale.
Une grande partie de la population leur venait en aide. Comme j'apprenais l'espagnol, avec d'autres élèves, nous leur rendions visite pour perfectionner notre savoir et aussi les soutenir. Ils venaient également dans l'agglomération et tous les gens les regardaient pour essayer de les réconforter.
Quelque chose m'a particulièrement frappé: lorsqu'un avion passait, ils criaient tous et essayaient de se cacher.
Georges NOUGAROLIS, à Campsas.
La construction du camp du Barcarès. -Photo archives «La Dépêche»
Voici venu le moment du départ. Mon oncle attèle les mulets au charreton. Nous chargeons tout ce dont nous avons besoin pour la route. C'est-à-dire des couvertures, des draps, des vêtements, de la nourriture. Heureusement, on avait tué le cochon. Le charreton était plein à croquer, si bien que, dans les côtes, il fallait pousser. Nous étions devenus de vrais gitans. On couchait et on mangeait dans les prés et, en plus, nous étions poursuivis par l'aviation de Franco. J'ai vu un homme partagé en deux par une bombe. Une autre fois, une mère qui portait son bébé sur son dos, un éclat d'obus a arraché la tête du bébé. A ma cousine, un éclat d'obus lui arracha le cuir chevelu.
Francisco CANALIS, à Condom.
Je suis né en Espagne en 1930 et je me souviens très bien de tout ce que j'ai subi. Ma famille et moi habitions à Moncada, près de Barcelone.
Début 1939, ma mère et mes frères ont décidé de se réfugier en France. En gare de Figueras, nous avons été bombardés par l'aviation allemande. Nous nous sommes abrités sous des wagons à bestiaux. Ensuite, nous avons pris la route du Perthus, perchés sur un camion surchargé. A quelques kilomètres de la frontière, nous avons été de nouveau bombardés par l'aviation allemande. Nous avons pu nous camoufler dans une forêt proche. Il n'y avait que des femmes, des enfants et des vieillards.
Après être passés par le Boulou, nous avons été envoyés dans un camp, à Guéret, dans la Creuse, où nous avons souffert de la faim durant un an. Je n'ai revu mon père qu'un an après.
Luis GARCÍA, à Saint-Orens.
Mon père était un guerillero «rojo». Après avoir fui l'Espagne, en 1937, il arrive en France, avec un contrat de travail pour les mines de Decazeville. Ma mère, mon deuxième frère et ma jeune soeur sont séparés de nous et partent vers le camp de Port-Vendres.
Pour ma soeur aînée, mes deux frères, mes deux soeurs et moi-même, la plus jeune, on nous embarque pour l'île d'Oléron. Là, les Français venaient nous voir comme des bêtes. En 1939, mon père peut nous réunir à Viviez, puis à Decazeville. Tous dans deux pièces misérables, mais heureux d'être ensemble.
MmeVIVES-COVADONGA, à Carcassonne.
—76→ —77→ —78→
Mon père, Louis, fonctionnoire des PTT, fut nommé en 1939, responsable du service postal dans le camp des réfugiés du Barcarès. Je ne sais quel courrier pouvaient recevoir ces exilés! Mais c'est ainsi que ma mère, mon frère, ma soeur jumelle et moi-même (5 ans) avons découvert le malheur et la misère des autres: fils de fer barbelés, faim, promiscuité, maladies, espoir et peur de l'avenir...
Je me souviens des points ronds et gris déchargés quotidiennement des wagons de trains et destinés aux occupants du camp. Nous sommes revenus à Toulouse en amenant avec nous un de ces réfugiés. Je suis a peu près sûr qu'il se nommait Ferrán. Il a vécu quelques mois dans notre appartement de la rue du Rempart-Villeneuve dont les fenêtres s'ouvraient sur les toits de la place Wilson. Puis, il nous a quittés et nous n'avons plus eu de ses nouvelles.
Georges LAMBERT, à Canals.
La frontière à peine passée, le
soldat républicain, exténué, s'endort.
-Photo archives «La Dépêche»
Je suis né à Irún et nous fûmes obligés de quitter la ville vers la mi-août 1936 car les troupes franquistes coupèrent la frontière avant la fin du mois d'août de cette année-là. Ensuite, réfugiés très peu de temps près de Bilbao.
Lors de la rupture de la «cintura de hierro» (la ceinture de fer), nous fûmes obligés d'aller à Santander pour embarquer sur un minéralier anglais pour débarquer à Bordeaux, nous envoyant à Montélimar pendant trois mois dans une caserne. C'était en juin 1937.
Libérés sur réclamation de mon père, nous rejoignons le Pays Basque français où mon père et mon frère trouvèrent du travail à l'usine d'aviation. Moi-même, obtenant mon certificat d'études en mai 1940. Pour être internés, le 24 octobre 1940, au camp de Guers, puis Agde et Rivesaltes, et être libérés début octobre 1941.
En 1946, nous rejoignons Toulouse où mon père, avec mon frère et moi, créa sa propre entreprise de vitraux d'art, que j'ai maintenue jusqu'à ma retraite, en 1991.
Jean-Marie ECHANIZ, à Toulouse.
Il faisait froid en cette fin mars 1938; il y avait de la neige sur les montagnes qui entourent Yesero, petit village aragonais.
L'ordre d'évacuation du village était donné, Ramón, le patriarche, avait réuni autour de lui sa famille: Isabel, son épouse et ses enfants.
Ils emmenaient avec eux «le macho» de «Abuelo Miguel», le mulet du grand père.
C'est au petit matin du 1er avril, que le convoi fut formé d'environ une centaine de personnes.
Lors de ce périple à travers les Pyrénées, il y eut des scènes tragi-comiques, comme cette femme qui portait sur sa tête un coffret garni de toutes ses économies qui perdit l'équilibre et son chargement en pièces dévalant les pentes de la montagne. Plus dramatique aussi cet enfant de 2 ans qui, trompant la vigilance de sa mère, tomba dans un précipice.
Enfin, après seize jours de drame et d'espérance, ils arrivèrent à la frontière française. Après lui avoir ôté ses harnachements, le petit mulet restera là regardant partir les rescapés: il semblait leur dire: «Vous me laissez là?».
Michel SANZ, à Agen.
En 1936, un dimanche matin, nous sommes partis avec des camarades socialistes à las Ramblas. Là, ont commencé les combats. Les premiers tirs ont eu lieu après de 100 mètres de la statue de Colon. Les combats étaient menés par Durruti et son compagnon Ascaso.
Dans l'après-midi, il s'est formé une colonne qui est partie en Aragón. Arrivée aux portes de Bujaraloz, elle n'a plus avancé.
C'est ainsi que lui est resté en Aragón. Il était chauffeur dans l'armée. Ma fille et moi étions réfugiées dans un petit village.
Quand l'armée de Franco a pénétré dans Barcelone, il est venu nous chercher.
Il avait pris, dans un hôpital, un camion dans lequel se trouvaient des blessés et des personnes âgées, et on a profité pour nous «récupérer» et nous amener à la frontière du Perthus, le 29 janvier 1939.
Arrivés à la frontière, nous avons abandonné le camion. On nous a fait rentrer par groupe de trente à quarante personnes et sommes arrivés au Boulou. Là, nous avons été séparés, femmes et enfants d'un côté et les hommes d'un autre.
Nous sommes restés sans nouvelles, et ceci pendant sept mois.
Mme et M. LOZANO, à Saint-Gaudens.
—79→
Mes parents dirigeaient une maison d'enfants dans les Pyrénées commingeoises. Et dans le village, arrivèrent quelques Espagnols. J'ai le souvenir d'un couple qu'on recueillit dans l'établissement. Ce couple d'Espagnols, Miguel et Pepita, avait une fille d'environ 5 ans dont je ne me rappelle plus le nom. Miguel fut embouché par mes parents comme jardinier, et Pepita, femme de service. Rapidement, ils surent se faire des amis. Je revois encore Miguel, la «boina» sur la tête, conduisant la voiture à cheval qui était notre seul moyen de transport. Pepita, elle, chantait tout le temps, en accomplissant son travail, des chansons de son pays, et mettait la bonne humeur autour d'elle.
Ils restèrent quelques temps.
Nous ne nous sommes jamais revus.
André COUVOT, à Toulouse.
Mon fiancé, Josep, parti combattre pour la République, n'était pas revenu. J'avais la certitude qu'il ne reviendrait pas. Un jour, un messager frappa à ma porte. Il était porteur d'une missive de Josep. Il était en vie, interné au camp du Barcarès. C'est d'un village catalan, au pied des Pyrénées, que Josep avait pris la route de l'exil, aidé par une famille. Josep m'écrivait qu'il me recommandait auprès de cette famille.
Je réussis à m'y rendre, mais les choses n'étaient plus ce qu'elles avaient été.
La maison était sous surveillance.
Personne ne pouvant m'aider, je décidais de partir à l'aventure. Lorsque j'arrivais au pied des Pyrénées, tous les chemins se ressemblaient.
Je pris le premier, qui me semblait le plus approchant de celui mentionné sur mon plan. Je marchais des heures, ayant l'impression de tourner en rond.
Après trois jours et trois nuits, à travers ronces et broussailles, j'aperçus, enfin, en contrebas, des prairies. «Les prairies françaises sont plus verdoyantes que les nôtres et lorsque tu apercevras des vaches paissant dans ces vertes prairies, tu seras en terre française», m'avait-on dit. Je dévalais la pente. Je tombais à terre à bout de force et, là, je m'endormis. Lorsque je m'éveillais, je vis l'ombre d'une forme humaine. Un homme me regardait l'air ébahi. Il avait compris d'où je venais. Je me levais tant bien que mal. Mes jambes blessées me faisaient mal. J'expliquais dans ma langue, le catalan, d'où je venais, où je voulais aller. Cet homme était des Pyrénées-Orientales et à quelques nuances près, nos langues étaient semblables. J'étais à Collioure
IL m'aida à marcher jusqu'à la route en contrebas, où là, je pourrais prendre l'autobus qui me mènerait à Barcarès. Je pris donc cet autobus et dès que j'en franchis la porte, tous les regards se portèrent sur moi. Soudain, au fond, je vis un jeune homme me regarder et porter son index devant sa bouche, comme pour me dire de me taire. Je descendis à Perpignan et alors que j'attendais l'autobus qui devait me conduire vers Barcarès, je vis s'approcher l'homme qui m'avait intimé le silence. «Je veux me rendre à Barcarès, rejoindre mon fiancé», lui dis-je. Il dit: «Je peux vous aider. Je suis l'interprète du camp et je peux vous y conduire. Demain, à l'occasion du 14 juillet, sous ma protection, vous pourrez pénétrer dans le camp. Mais, pour l'heure, il faut soigner vos jambes et passer une bonne nuit». L'aubergiste de Barcarès m'accueillit à bras ouverts.
Le lendemain matin, mon protecteur vint me chercher et m'invita à monter dans une camionnette qui nous conduisit au camp de Barcarés.
Dolores BÁRBARA, à Tournefeuille.
Ce n'est que vers 1938-1939, que nous avons vu, de la fenêtre de ma chambre, à Port-Vendres, ce qu'était un bombardement aérien. J'avais alors 12 ans.
A la tombée de la nuit, des bruits d'explosions et des lueurs dans le ciel, côté frontière.
Plus tard, vers 1939, pendant «la retirada», l'exode, la France avait fait venir dans le port de Port-Vendres, un navire hôpital «Le Maréchal-Lyautey».
Dans un hangar, en face du navire, ils avaient mis de la paille par terre pour que tous ces réfugiés puissent se reposer, exténués qu'ils étaient.
Mon père était douanier. J'étais avec lui, un jour, car il faisait le recensement des gens qui passaient la frontière et des blessés. Une pauvre dame exténuée m'a dit: «Hoy par nosotros, mañana por ti». Ce qui veut dire.: «Aujourd'hui pour nous, demain pour toi». Elle ne se trompait pas.
Le soir, vers 18 heures, avec ma grand-mère et ma mère, nous coupions des tranches de pain, des bouts de fromage, et nous descendions sur le port donner à manger à chacun.
Raymond RADONDE, à Guzen.
Carte d'un aviateur allemand... -Photo archives «La Dépêche»
Fête de la Victoire, pour Franco et ses troupes,
le 20 mai 1939,à Madrid.
-Photo archives «La Dépêche»
Le Maures du Caudillo sont célébrés à Burgos. -Photo archives «La Dépêche»
—[81]→La bonne humeur semble revenue à Madrid,
même si elle est en trompe-l'oeil.
-Photo archives
«La Dépêche»
En 1939, nous vivions à Figueras. Mes grands-parents maternels étaient français et résidaient à Toulouse. Mon grand-père, détaché de l'ambassade de France à Barcelone, avait réintégré Toulouse à la suite du conflit espagnol. Mon père était de la branche catalane. Il était au front. Notre maison de Figueras avait été totalement détruite lors d'un bombardement.
En 1941, mon grand-père obtint, je ne sais comment, à me faire passer la frontière —82→ et me récupéra à Cerbère. J'avais alors 8 ans. Mais mon grand-père participait activement à la Résistance. Arrêté, il mourut à Buchenwald. Je me retrouvai seul avec ma grand-mère, pas sans rien, mais presque. Nous devions subsister avec quelques aides que les membres du réseau réussissaient à nous faire parvenir.
En 1947, ma grand-mère fut tuée par une voiture et ma mère, qui pouvait se prévaloir de parents français, obtint l'autorisation de venir à Toulouse, accompagnée de mon frère et de ma soeur.
Français FORNS, à Toulouse.
Nous, les hommes, nous avons été mobilisés pour faire des fortifications. On nous donnait comme à un soldat: 10 pesetas et la ration alimentaire. Quant à moi, comme on a trouvé que j'étais trop petit pour manier la pelle et la pioche, on m'a mis avec le commandant pour inspecter des positions. On est resté là jusqu'à la fin de 1938. L'offensive suivante nous a conduits à la frontière.
Pour nous nourrir, nous allions chercher les vivres que les associations distribuaient. J'avais trouvé un vélo; il m'a servi à aller chercher du pain plus loin; je l'ai ramené à ma famille. Pour avoir une autre ration, j'y retourne mais je suis reconnu. Le gendarme de service me parle; je ne comprends pas ce qu'il me dit; il me donne alors un bon coup de pied où derrière. Ça je l'ai compris!
On nous a embarqués, ensuite, vers Le Vigan.
Je ne suis pas allé à l'école en France, au début; j'ai tenté, mais comme je ne connaissais pas la langue et qu'il n'y avait personne pour m'accompagner, j'ai rebroussé chemin.
M. VENTURA CODINA, à Saint-Gaudens.
Février 1939: des oeuvres d'art des musées
espagnols qui avaient
été entreposées
à Céret sont acheminées vers Genève.
-Photo archives «La Dépêche»
Née dans un petit village d'Aragón, partagé entre les deux tendances: la République et la Phalange, avec un café pour chaque. Mon père, après avoir participé à la lutte pour la République, est, en 1939, rentré en France.
En 1947, avec les économies d'ouvrier agricole, il a payé des passeurs pour nous faire rentrer, aussi. Ma mère avec ses quatre enfants, le jour de mes 11 ans, nous avons traversé à marée basse, de Irún à Hendaye, la nuit éclairée par les phares des carabiniers, la frontière où nous avons retrouvé notre père et notre nouvelle patrie. C'était bien le jour le plus beau.
Mme CARME-RUIZ, à Toulouse.
Je vous adresse des témoignages sur des événements survenus au lendemain de la guerre civile en Espagne. Ils concernent l'aide que j'ai apportée à certains réfugiés.
J'ai hésité à retransmettre des souvenirs. Ceux qui ont aidé les exilés ne doivent pas tomber dans un excès de vanité.
Au début du mois de mars 1939, une personne d'origine espagnole recevait une lettre d'un neveu, âgé de 17 ans, blessé au combat et hospitalisé à Perpignan. Il demandait asile chez elle, à Mauvezin. J'avais accepté de me rendre à Perpignan, avec ma voiture, pour recueillir le jeune Espagnol. L'autorisation d'héberger un sujet espagnol était conditionnée à l'accord du préfet.
Le préfet, en personne, me remit le document. Je devais ensuite me présenter à la préfecture de Perpignan. Le blessé avait été transféré au camp d'Argelès-sur-Mer, implanté sur la plage, où je me suis rendu... En 1940, il fut possible de rapatrier cet Espagnol dans sa famille à Barcelone, avec la bienveillance du consul d'Espagne à Auch. Au mois de juillet 1939, un autre neveu de la même personne manifesta sa présence au camp du Vernet. L'autorisation de séjourner dans le Gers était conditionnée à un contrat de travail. Il fut possible de lui trouver un emploi. Quelques jours plus tard, j'allais le chercher au Vernet. Cet ouvrier boulanger donna entière satisfaction.
G. GAUDRON, à Blagnac.
Photo de famille au Col du Portillon:
gardes-mobiles
et douaniers français aux côtés
des soldats nationalistes.
-Photo archives «La Dépêche»
Je suis né en 1938, à Palencia, chef-lieu de province de cette ancienne province del «Reinado7 de León», faisant partie, maintenant, de la Vieille Castille. Je n'ai pas connu mon père, porté disparu. Mineur dans les Asturies, fait prisonnier à la fin de cette guerre, ma mère n'a jamais pu savoir ce qu'il était devenu.
En 1949, mon frère aîné, a reçu son appel sous les drapeaux. Il a jugé inacceptable de servir sous la bannière de ceux qui avaient assassiné son père. Il est parti en France.
A cette époque, la frontière —83→ avec la France étant fermée, son passage ne pouvait se faire que clandestinement. Resté en Espagne avec ma mère, celle-ci a décidé de venir les rejoindre.
Nous avons franchi la frontière au-dessus de Puigcerdá et nous nous sommes rendus aux douaniers de Bourg-Madame. Nous avons subi un premier interrogatoire et après un dîner avec d'autres clandestins, on nous a fait savoir que l'Etat français ne pouvait nous accorder l'asile. C'est pourquoi, on nous a fait traverser la rivière séparant les deux pays dans un endroit où, en principe, nous devions échapper aux autorités espagnoles. Lorsque, nos guides nous ont laissés, nous avons décidé de rebrousser chemin.
Nous avons fait le trajet Bourg-Madame-Perpignan, à pied. Nous avons dépassé Perpignan car nous avions l'intention d'aller jusqu'à Lyon. Je n'en pouvais plus; j'avais 11 ans. Refusant d'aller plus loin, nous avons été pris en charge par un gendarme passant par hasard et intrigué par notre couple. Il nous a amenés à la gendarmerie. De là, nous avons été ramenés au camp de transit de Perpignan. Nous y sommes restés une quinzaine de jours.
Journellement, ma mère subissait des interrogatoires, afin de savoir les raisons de notre passage. Invariablement, elle disait que ses fils étant en France, son seul désir était de les retrouver. Au bout d'une quinzaine, on nous amena sous bonne escorte, comme des voleurs, en gare de Perpignan. Encadrés par des hommes armés, on nous amena à Cerbère. Durant la nuit, on nous fit passer la frontière, encore une fois par des endroits échappant aux douaniers espagnols.
Comme à Bourg-Madame, dès que nous fûmes seuls, nous avons repris le chemin de la France...
Andrès RENEDO, à Vouzon.
Puis-je, moi, fils de réfugié espagnol, garder le mutisme sur cette page de l'Histoire?
Tout d'abord, le statut de «réfugié politique», ces Espagnols, ils en étaient très fiers car c'était, pour eux, comme une reconnaissance officielle qui leur était attribuée.
Rien d'étonnant si ces hommes ont été des premiers à rejoindre le «maquis».
A l'université, mon père avait été enthousiasmé par la déclaration des Droits de l'Homme et la «Marseillaise» qui symbolisaient, à ses yeux la liberté, l'égalité et la fraternité.
Comment oublier que, pendant toute ma petite enfance, ma maison était le lieu de rendez-vous de réfugiés, de passage à Agen, qui venaient boire un café en disant que la situation allait bientôt changer en Espagne. C'est d'ailleurs l'espoir qui les a fait vivre la tête haute.
Comment oublier qu'à la fin de la guerre, quelques trop rares rescapés des camps faisaient halte à la maison pour se réconforter et, surtout, surprenaient tout le monde par le silence qu'ils souhaitaient garder sur ce qu'ils avaient vu et vécu dans ces camps d'extermination.
Comment oublier que mon père, qui était dans le corps médical en Espagne, était devenu manoeuvre mécanicien en France, et ce, pour rester fidèle à un «idéal».
Pierre PÉREZ, à Escalquens.
La guerre approchait de la Catalogne. Nous avons quitté le village vers la frontière. Mais, par peur de traverser les Pyrénées, en ce mois de janvier plein de neige, nous avons attendu le passage des nationalistes pour se mettre en route vers Barcelone.
La première des choses ci été, pour ma mère, de se camoufler. Il fallait allaiter ma soeur, trouvant refuge six mois d'un côté, six mois de l'autre.
Mais la police est venue la chercher. Ils l'ont fait mettre toute nue et lui ont donné des coups de matraque en lui demandant où se trouvait son mari. Elle ne put répondre. Il était réfugié en France depuis février 1939. Ramenée à la prison, soignée par les prisonnières, elle est restée vingt-deux mois. Heureusement qu'il y avait les soeurs de mon père qui m'ont gardé. Et j'ai pu aller à l'école.
Joaquim TRASSERAS, à Auch.
Les franquistes
hissent le drapeau nationaliste au poste frontière
du Perthus.
-Photo archives «La Dépêche»
Je vous adresse le double de la lettre adressée à mes parents en 1944:
«Mes chers parents,
Voici déjà cinq années exactement que je me trouve en France. Cinq ans et demi, donc, que je ne vous ai plus vus. La dernière fois, c'était le 21 juin 1938 que je suis descendu du front, attristé, pour vous embrasser et pleurer avec vous mon très cher et unique frère José, mort au combat.
Ensuite, c'est au milieu de cette immense douleur et entre les muettes et inoubliables larmes de ma chère mère que je dois regagner mon poste à la première ligne de feu, d'où, le 10 février 1939, j'ai réussi, avec une poignée de braves combattants, à franchir la frontière et rentrer dans ce pays voisin qui nous accueille et nous sauve.»
Antoine PAGES, à Savarthès.
—84→Le préfet des Pyrénées-Orientales visite le camp du Barcarès. -Photo archives «La Dépêche»
Février 1940: les décrets Pétain ont ramené les femmes exilées à leur mari en Espagne avec les enfants. Ici, à Magnac-Laval, on les a mises dans des trains. Dolores a été oubliée dans la liste des partants, par contre, Carlitos, le jeune réfugié madrilène, et Clara, sa soeur sourde et muette, sont sur la liste. Dolores ronge son frein. Miquela, son amie des camps, l'exhorte à rester, à les laisser partir seuls puisqu'une autre amie est du convoi. La promesse faite au père mourant ronge Dolores. L'instinct de mère aussi: laisser partir le petit Carlos qui l'appelle «maman» lui paraît une lâcheté. Une malveillance reléguera tous ses scrupules aux oubliettes, un délégué de camp, un Espagnol, la désignera elle aussi.
Le convoi s'ébranle. Ils arriveront, nos trois exilés, au pied des Pyrénées, à Ripoll. C'est un vendredi froid du mois de février.
Le lendemain, par je ne sais quel éclair de génie, aussi parce que Carlitos est là et qu'il faut régulariser sa situation depuis que sa mère madrilène le réclame, Dolores va se rendre au commissariat de police. Qu'est ce qui a poussé cette «honnête» femme à cette démarche? Entourée de Carlos Fernández Medrano, 9 ans maintenant, et Clara Prat, la sueur sourde et muette, elle part. Qu'est ce qui fait qu'elle ne s'est pas cachée, terrée?
Le chemin assez long pour se rendre au commissariat est avalé rapidement pour ne pas penser. Un coup de maître d'échecs. La porte d'entrée est franchie: plusieurs personnes attendent.
La seule chose que tu sais, c'est que c'est ton tour. Tu commences par régulariser la situation du petit réfugié qui t'a été confié. Tu as l'air de «Madame Tout le Monde», d'une «paysanne» un peu balourde qui ne comprend pas tout ce que l'on dit. Tu réponds simplement aux premières questions du policier. Quand, tout à coup, ayant consulté ses fiches, le commissaire se lève d'un bond. Il s'étrangle. Il lit d'un seul trait le contenu de la fiche. «Dolores Prat Marjanet, secrétaire CNT de l'industrie du textile, connue de longue date pour ses activités révolutionnaires et ses idées marxistes. A l'heure qu'il est, vous devriez être fusillée; dans tous les cas, vingt ans de prison, personne ne pourra vous les éviter!» Il suffoque.
«Je peux parler, dit Dolores. J'ai bien été secrétaire de l'industrie du textile mais seulement de Ripoll et, par contre, ça je peux vous l'assurer, je n'ai jamais été marxiste.» Il lui avait lancé l'insulte suprême: marxiste! Et puis, avec sa bonne foi de femme honnête, avec la voix d'un vainqueur et non d'un vaincu, elle continue: «Personne à Ripoll ne pourra vous dire que le j'ai insulté et vous ne trouverez chez moi-même pas une aiguille qui ne m'appartienne pas.»
Des secondes qui paraissent des siècles. Le commissaire est troublé, mille choses dans son crâne; en tout cas, il ne reconnaît pas le discours habituel. Cette femme, cette paysanne... Peut-être les fiches exagèrent-elles? En tout cas, il n'a pas, lui non plus, la réponse habituelle: « Rentrez chez vous, ne vous mêlez de rien et surtout pas de réunions!» Dolores s'efforce de maîtriser sa surprise. Elle tourne les talons avec naturel, repart lentement. Elle sursaute, une voix dans son dos, ça y est, il a changé d'avis: «Ecoutez bien ce que je vois vous dire! Aujourd'hui, c'est moi, demain, ce peut être quelqu'un d'autre». «Je vous entends bien», répond-elle. Dans la salle d'attente, l'enfant, le handicapée, sont là; ils repartent tous les trois.
Progreso MARÍN, à Tournefeuille.
Des orphelins recueillis dans un asile
tenu par des religieuses.
-Photo archives «La Dépêche»
C'était à Barcelone, le 26 janvier 1939. J'avais 13 ans; je sortais du restaurant réservé aux enfants des écoles. Dehors, dans l'avenue de Les Corts Catalans, les troupes maures avançaient. Un officier fasciste est sorti de la colonne, est venu vers la porte du restaurant et, avec une voix tonitruante, nous a dit que par ordre du gouvernement: «Este restaurante queda clausurado» (ce restaurant sera fermé). Que, dorénavant, l'Espagne éternelle allait faire de nous des bons et loyaux chrétiens.
Je me rappelle que l'officier en question portait sur sa poitrine une image du Sacré-Coeur où il était inscrit «detente bala» (arrête-toi balle).
J'ai été obligé de quitter l'école malgré mon jeune âge et j'ai commencé à travailler pour survivre et aider la famille.
Il y avait un organisme qui s'appelait «Auxilio social». Pendant des mois, ils faisaient bouillir dans d'énormes marmites des légumes secs avariés. Les jeunes filles faisaient la distribution. C'étaient des phalangistes, elles s'appelaient «Margaritas», habillées avec jupe noire, chemise bleue, béret rouge et —85→ le joug et les flèches comme distinctif fasciste. Il y avait une cheftaine «Margarita», peu gratifiée par la nature, qui faisait, de temps en temps, la tournée des marmites. Et le jour où elle tombait sur notre quartier, elle obligeait les gens à crier: «Viva Franco» et «Arriba España». Nous on préférait partir à la maison et serrer la ceinture que donner satisfaction à cette harpie.
Pedro FERNÁNDEZ, à Albi.
Au mois de mars 1939, alors que la guerre civile est sur le point de s'achever, je suis rappelé à mon régiment basé à Tarbes, le 2 Régiment des Hussards motorisés.
Vers la mi-mai, on demandait des volontaires pour rapatrier en Espagne les véhicules des réfugiés républicains que ces derniers avaient introduits en France lors de leur déroute. Avec quelques camarades hussards, encadrés par nos officiers, nous avons donc conduit ces véhicules. Nous avons acheminé les voitures pendant un mois et demi jusqu'à Hendaye par Saint-jean-de-Luz, Bayonne et Biarritz, à raison de deux voyages quotidiens comprenant chaque fois environ quinze véhicules.
Ernest RESSEGUIER, à Albi.
J'ai été le «pensionnaire» contraint et forcé, de novembre 1940 à janvier 1942, de la prison La Modelo à Barcelone. J'en suis sorti avec un soulagement évident. Lors de mon séjour en prison, une fois par mois, le vendredi de la dernière semaine, le haut parleur de la cour, à 4 heures, crachotait une dizaine de noms qui disparaissaient car, à 6 heures, les individus portant ces noms étaient fusillés dans la carrière désaffectée, à l'arrière du château de Montjuïc.
Comment en étais-je arrivé là? En 1939, le 25 juillet, j'avais 18 ans, avec des idées plutôt marxistes. En juillet 1940, en France, je participais, envers et contre tous, à des réunions clandestines. Au cours d'une d'elles, il y eut une descente de police. J'eus la chance d'en réchapper à la faveur de la mêlée qui s'en suivit, en me hissant par un soupirail de la cave qui donnait rue des Gestes, à Toulouse, en compagnie de deux compagnons. Quinze jours plus tard, j'étais en Espagne. Et tout commença à se gâter. Je fus arrêté par la Guardia civil, fin août, et transféré au camp de concentration de Reus. Interrogatoires trois fois par semaine: «Combien de religieuses as-tu violées avant de brûler couvents et églises?» Cet épisode dura trois mois. En novembre 1940, je fus transféré à la prison La Modelo à Barcelone.
Jacques SÁNCHEZ, à Toulouse.
Les troupes franquistes
défilent dans Barcelone.
-Photo archives «La Dépêche»
J'ai vu le jour le 9 mars 1911, dans le petit village de Recas, situé entre Madrid et Tolède. Le commerce y est très florissant, ma famille elle-même en vit très bien puisqu'elle y possède un hôtel-restaurant. Nous y recevons du «beau monde», d'autant plus que mon père (capitaine) et mon grand-père (lieutenant-colonel) ont servi dans la cavalerie des rois a Espagne.
Ainsi, notre famille «supporte» très difficilement les contraintes «anarchiques» de la «jeune» République espagnole.
En janvier 1936, à 25 ans, je prends la décision de rejoindre mes deux soeurs aînées mariées et vivant à Madrid, pour m'y perfectionner en couture.
A mon arrivée, je suis inscrite dans une «academia» de couture, située à proximité d'une caserne, au centre de la capitale. C'est sans doute pour cela qu'au déclenchement des hostilités, je me retrouve dans ce «cuartel» militaire, réquisitionnée avec mes camarades pour confectionner ou réparer des tenues militaires ou même des parachutes.
Au début de l'année 1937, je fais la connaissance d'un jeune sergent républicain, andalou, prénommé Juan, lui-même «monté» depuis 1934 à Madrid.
En juillet 1937, après nous être mariés civilement dans la caserne, nous fuyons l'avancée franquiste avec le régiment de mon mari et le futur enfant que je porte en moi. Nous arrivons à Valence. Vers la mi-janvier 1939, nous quittons rapidement cette ville pour Barcelone. Aussitôt arrivés, nous sommes obligés de repartir en direction du nord. Malgré la séparation d'avec mon mari, j'ai la chance d'être transportée, à cause de mon état de grossesse avancé, sur le plateau découvert d'un camion militaire. Nous parvenons à pied jusqu'au village catalan du Boulou.
Je donne malgré tout la vie à mon fils Juan (comme son père), le 27 mars 1939.
Après quelques mois passés dans le camp d'Argelès, nous eûmes la joie, avec mon enfant, d'être à nouveau réunis avec mon mari, lui-même «détenu» dans le camp des hommes d'Argelès.
Par la suite, nous fûmes expédiés vers le département de Lot-et-Garonne.
A peine arrivés à Agen, nous fûmes «réclamés» par les autorités municipales —86→ de Monflanquin, très humanistes à l'époque, et dont certains membres avaient même été volontaires dans les brigades internationales.
Une certaine partie de la population (la majorité) ne nous acceptait pas du tout, car nous représentions pour elle la «horde sauvage des rouges» ou les «bouffeurs de curés». Certains allaient même jusqu'à dire ou écrire que les femmes espagnoles portaient des queues comme des guenons...
A la fin du mois de mars 1940 quand mon mari et moi-même sommes enrôlés dans une compagnie de travailleurs étrangers et expédiés vers une usine d'armement située à Pontigny. A peine installés, l'avancée des troupes allemandes est telle que la débâcle nous oblige de repartir vers le sud. Après avoir rencontré une camarade espagnole avec ses deux petits enfants, installés sur le plateau d'un camion à gazogène, nous lui confions notre bébé avec une mollette, avec mission et espoir de nous retrouver dans la ville suivante: Nevers.
A notre arrivée, la ville venait d'être bombardée. Nous sommes obligés de poursuivre notre route, sans avoir pu obtenir des nouvelles de notre fils. Nous arrivons, de nouveau, à Monflanquin.
Aussitôt, nous entreprîmes des recherches. Elles aboutirent quatorze mois après, grâce à la providence d'une lettre que j'avais reçue de mon frère aîné, resté à Madrid. Cette lettre ayant été récupérée à l'intérieur de la petite malle qui accompagnait notre fils Juan, par une comtesse, membre de la Croix-Rouge, à qui il avait été confié par ma camarade Conchita lors de sa fuite avec le camion.
Ainsi, avec l'adresse figurant au dos de l'enveloppe, la comtesse put localiser mon frère à Madrid. Après de longues correspondances, en avril 1941, nous pûmes récupérer notre fils à la gare de Monsempron-Libas, accompagné par cette magnifique comtesse en personne, toute habillée de blanc, avec sa toque à Croix-Rouge.
En juillet 1953, grâce à ma famille faisant partie de la classe dirigeante de mon village, j'obtins un visa d'entrée en Espagne. Je dus, malheureusement, écourter ce premier séjour dans mon village devenu mal accueillant et franquiste jusqu'à la pointe du clocher. Car j'avais oublié que, partie en janvier 1936, en «Juana la Católica», j'en revenais dix-sept ans après en «Juana La Roja».
Jeanne MORENTE-ALVÁREZ, à Villeneuve-sur-Lot.
La foule, pour l'entrée des troupes de Franco à Madrid. -Photo archives «La Dépêche»
Juillet 1936, je me souviens...
Je suis encore un adolescent, j'ai 15 ans. L'Espagne, c'est juste derrière ces pics enneigés que l'on peut découvrir de temps à autre de mon village, au lever du soleil.
Mon père est un fidèle lecteur de «La Dépêche du Midi» et les nouvelles ne sont pas bonnes. Il proteste et il n'est pas le seul. «Pourquoi, dit-il, le gouvernement français issu du Front populaire applique à la lettre la politique de non intervention?»
En mars 1939, j'assiste à l'arrivée des réfugiés à Caussade. Près de l'entrée du camp, un mirador.
Malgré l'interdiction d'approcher nous parvenons avec mon père à distribuer à la sauvette quelques paquets de cigarettes.
Le hasard voulut que, quelques jours plus tard, au matin, deux de ces malheureux réfugiés, après avoir erré toute la nuit et à bout de forces, topent à notre porte. Trempés et paralysés par le froid et la faim, ils furent réconfortés par mes parents.
Le 3 septembre de la même année, c'était la guerre contre l'Allemagne. Pour faire face à la pénurie de main d'oeuvre les agriculteurs purent utiliser des réfugiés civils espagnols.
En novembre 1942, lors de l'occupation de la zone Sud, le camp de Septfonds a heureusement perdu une grosse partie de ses effectifs. A la fin de 1943, la Résistance organise dans nos communes une filière qui va permettre aux clandestins de rejoindre les maquis du Lot. Dans la nuit du 22 février 1944, un des maquis exécute une opération contre le camp de Septfonds. Le premier objectif consiste à libérer des détenus de la prison du camp.
Je participe à cette opération avec les Espagnols du groupe de Belfort-du-Quercy. Trois combattants des Brigades internationales sont libérés, ils sont de nationalité allemande et s'engageront dans les maquis du Lot. En avril 1944, une compagnie FTPF est formée exclusivement d'anciens guérilleros espagnols.
Si soixante ans plus tard j'écris ce témoignage, c'est uniquement pour rendre hommage à tous ces combattants, hommes et femmes, qui dans leur pays d'accueil ont fait le sacrifice de leur vie en livrant leur dernier combat pour la liberté.
Roger CAMINEL, à Belfort-du-Quercy.
Coupe de cheveux au camp d'Argelès. -Photo archives «La Dépêche»
—87→
Je vous adresse la copie d'une lettre que nous avons reçue de notre oncle alors qu'il était enfermé à la prison de Sabadell en 1940.
Il avait été milicien, puis soldat du côté républicain et il avait été fait prisonnier sur le front de Valence. Pour le juger, ils l'ont transféré à Sabadell, sa ville natale. Condamné à mort, il a eu sa peine ramenée à trente ans de prison. Ayant découvert en lui un don particulier pour la peinture artistique, il a été contraint de travailler à la remise en état des retables et peintures des églises, notamment à l'église de Vic, province de Barcelone.
Marie PERA DÍAZ, à Saint-Juéry.